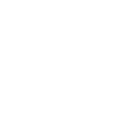Textes extraits de « Pierre Gassendi (1592-1655), L’homme en son temps » Bernard LEURQUIN. Chroniques de Haute-Provence N° 350, 2003
Pierre GASSEND, dit GASSENDI : sa jeunesse, la formation de sa personnalité
Pierre Gassend est né dans le petit village provençal de Champtercier le 22 janvier 1592, entre 6 heures et 7 heures du matin, dans le hameau isolé de la Grau. Il est mort à Paris, le 24 octobre 1655, à 4 heures de l’après-midi, âgé de 63 ans et 9 mois.
Certains commentateurs estiment que la famille était plutôt aisée, alors que la tradition veut que Gassendi soit né dans une famille de paysans pauvres. Il sera, en tous cas, entouré d’affection par des parents très droits et très croyants.
Tous les auteurs s’accordent pour reconnaître à Gassendi un naturel doux, tranquille, obéissant, studieux et pour affirmer qu’il s’exprimait avec facilité dès l’âge de dix-huit mois et qu’il faisait preuve de beaucoup de mémoire. Ils le décrivent comme ayant une complexion fragile, souffrant de presque toutes les maladies d’enfant, mais soigné avec une détermination rare par ses parents qui le confient aux soins de médecins. Il est vrai que les parents de Pierre étaient incités à cette dépense par les décès successifs de leurs enfants et que Pierre était le premier garçon.
La précocité de l’enfant, son amour passionné pour les études, sa facilité pour retenir tout ce qu’il entendait puis pour le répéter à ses camarades, son goût pour les livres sont entrés dans la légende. D’autres sources nous apprennent, le curé Fabri, oncle maternel de l’enfant, lui ayant appris les premiers éléments de lecture, que « son ardeur est extrême ; le jour ne suffisait pas, il étudiait encore une partie de la nuit à la lueur de la lampe de l’église », on comprend que nous sommes en présence de ce que, dans le vocabulaire moderne, nous appellerions un « enfant surdoué ». Tous les signes sont là : rapide apprentissage de la parole, intelligence exceptionnellement vive, mémoire prodigieuse, amour de la lecture et des livres, appris quasiment par cœur sans le moindre effort, et en même temps, sens aigu de l’observation et de la déduction logique, accompagné de l’envie de faire partager et même de faire comprendre ses découvertes aux autres.
Restait un écueil de taille pour un jeune enfant passionné de livres : la plupart de ceux qui pouvaient être à sa disposition étaient rédigés en latin ! Il fallait donc que le garçonnet apprenne cette langue. D’où la décision de l’envoyer à Digne « pour étudier au latin ». Pierre a 8 ans. En moins de deux ans, il manipule la langue latine avec assez de brio pour être capable de composer dans cette langue une harangue qu’il prononcera lui-même devant le nouvel évêque de Digne. L’enfant a tout juste 10 ans.
A 16-17 ans, le jeune Pierre a franchi les étapes des études secondaires et conquis l’amitié et la reconnaissance de la ville chef-lieu. Il se retire alors à Champtercier et consacre cette période « à étudier la plus grande partie des nuits ». Cette habitude de travail nocturne qui persistera toute sa vie, éveillera sans doute sa vocation pour l’astronomie, qui ne se révèlera que plus tardivement. Ce séjour studieux au village natal lui permet d’attendre son entrée à l’Université d’Aix-en-Provence.
A Aix, il étudiera pendant trois ou quatre ans, d’abord la philosophie, puis en théologie, ce qui le destine au sacerdoce. Pierre Gassendi s’adonne aux études « avec fureur », apprend la langue grecque et l’hébreu. Il lit les auteurs anciens, mais aussi Montaigne, mort l’année de sa naissance. Le futur Gassendi trouve, dans cette ville aux multiples bibliothèques, au clergé éclairé et aux magistrats très cultivés, un milieu favorable pour le développement de sa pensée et de son érudition. Venu à Aix dans le cadre d’un « cursus universitaire » et ecclésiastique, il en repartira avec une personnalité toute construite comme avec l’embryon d’une philosophie contestataire. Car, tout en s’appuyant sur les cahiers de son maître, qui enseigne la philosophie « aristotelicienne », il prépare déjà les arguments réfutant cette philosophie officielle.
Il accepte pendant deux années (1612-1614) la direction du Collège de Digne, et cumulera les fonctions de directeur de l’établissement et professeur. Sa vocation pour le sacerdoce s’affirme, et en 1614, à l’âge de 22 ans, il se fait remettre les quatre ordres mineurs et celui de sous-diacre. Il part pour Avignon pour soutenir sa thèse de théologie et obtient très brillamment « le bonnet de docteur ». Son succès et son éloquence lors de sa soutenance de thèse sont tels qu’on lui propose immédiatement un poste de « théologal » au chapitre de Forcalquier, puis à la cathédrale de Digne. Il se fait ordonner prêtre le premier août 1617, il a 25 ans.
Désormais, il va pouvoir laisser s’épanouir sa personnalité. Deux chaires de professeur étant vacantes au Collège d’Aix, celle de philosophie et celle de théologie, il se met sur les rangs et emporte les deux. Il se contentera de celle de philosophie, qu’il assurera pendant 5 ans, de 1617 à 1622, donc de 25 à 30 ans. Il innove d’emblée, osant enfin sortir des sentiers battus, pour combattre les doctrines du philosophe grec Aristote. Ses cours deviennent vite célèbres et, outre les étudiants, y assistent les hommes les plus éminents de la ville. Sa notoriété s’accroît.
Il se lie à deux extraordinaires amis, auxquels il restera fidèle toute sa vie : Joseph Gautier, Prieur de la Valette, vicaire de l’Archevêque, dont la passion est les mathématiques, science qui comprend à l’époque l’astronomie, et Claude Nicolas Fabry de Peyresc, Conseiller au Parlement, qui possède une fabuleuse bibliothèque, collectionne les « antiques » et notamment les monnaies anciennes, a voyagé dans l’Europe entière et correspond avec tous les savants de l’Occident. En se liant à ces deux hommes, Pierre Gassendi trouve, outre une chaleur amicale, des initiateurs dans le domaine où il sera, à mon sens, le plus brillant : l’astronomie. Mais aussi, une sorte de mécénat, pour le gîte et le couvert, comme pour réunir les manuscrits des textes anciens dont il aura besoin pour ses écrits. Enfin, ce séjour aixois offre à Pierre Gassendi la possibilité de se constituer un réseau de relation, d’abord la bonne Société, parlementaires, religieux et quelques nobles, mais aussi il entre dans le réseau de correspondance scientifique du monde occidental.
D’une intelligence supérieure aidée par une prodigieuse mémoire, le fils du petit agriculteur de Champtercier a, entre et 25 et 30 ans, enfin assuré sa place dans le monde de son époque : prêtre et professeur, membre du chapitre de Digne, il a un statut – homme seul, il a trouvé des amis – il dispose d’un réseau de relations scientifiques et mondaines – il a trouvé une modeste indépendance financière – il a découvert la science qui le comblera le plus, l’astronomie, et, jusqu’à la fin de sa vie, il tiendra un journal quotidien, un « diaire » – il ose enfin exprimer des idées originales et personnelles, et il va les jeter sur papier, pour publication. L’homme Gassendi est achevé.
Pierre Gassendi : l’homme mûr et l’élaboration d’une œuvre. La conquête d’une renommée internationale.
Après cette étude de « l’irrésistible ascension sociale d’un fils de paysan provençal XVIIème siècle », nous allons suivre « l’homme mûr », sa conquête de la renommée sous le nom de Gassendi, et son travail acharné pour laisser une œuvre.
En 1622, venu se reposer après les épuisants travaux de son ascension, Pierre Gassend, qui assume sa charge de théologal, met la dernière main à son manuscrit sur Aristote. Il n’a pas l’intention de publier mais fait lire cette première œuvre à ses amis qui l’incitent à se faire imprimer. Ecrivant en latin, il signe Gassendus, avec un grand paraphe en queue de mot, et déjà, ses secrétaires prennent l’habitude d’ajouter à son nom un « i » de déférence, à l’italienne, ce qui est une marque de quasi-noblesse.
Et soudain, une occasion se présente pour lui : le chapitre de Digne est en procès et sa cause va être évoquée devant le parlement de Grenoble : il presse Gassendi de faire le déplacement pour soutenir sa cause. C’est donc à Grenoble, en 1623-1624, que paraitront « les exercitations contre les sectateurs d’Aristote ». Gassendi part, en 1624, passer 5 ou 7 mois à Paris pour juger du résultat. On peut comprendre l’inquiétude du jeune auteur : il vient d’oser attaquer, par écrit, tous les dogmes de la « scholastique », c’est à dire tout ce qui était enseigné par l’Eglise dans les écoles.
Ce séjour parisien lui sera utile : il s’y liera avec l’un des plus grands penseurs de l’époque, les père Mersenne, et c’est sans doute sur les conseils de ce dernier qu’il abandonnera l’idée de donner une suite à un ouvrage qui risque de la ranger dans le camp dangereux des athées. C’est aussi pendant ce séjour à Paris qu’il se lie avec quelques « libertins », c’est à dire avec tous ceux qui revendiquent « la liberté de penser » par rapport au dogme établi.
Après un bref retour à Grenoble pour s’occuper du procès du chapitre, séjour qui lui permet d’entrer en correspondance avec Galilée, il rentre à Digne où il restera un peu plus de deux ans (1626-28). Il prêche à la cathédrale, mais surtout, multiplie les observations astronomiques et entretient une volumineuse correspondance. Une partie de ses lettres, et notamment ses observations astronomiques, donne lieu à des publications partielles et sa réputation d’astronome s’étend.
A 36 ans (automne 1628) Gassendi repart sur Paris et entreprend un voyage dans les pays du Nord (Belgique et Hollande) afin de faire connaissance avec tous les savants. Malgré ses désirs ultérieurs, ce sera son seul voyage hors de nos frontières. C’est, en tous cas un voyage studieux, à l’emploi du temps dément, puisque, outre les temps de déplacements et les visites d’hommes de science, il comprend : de jour, des observations multiples sur tous les sujets, cristaux de neige, boues rouges, îles flottantes de Saint-Omer, etc… et, de nuit, des observations astronomiques, mais aussi d’innombrables lettres, contenant des détails d’anatomie, une étude sur les avantages du régime végétarien, une autre sur les phénomènes lumineux du soleil, « les parhélies », sans oublier un ouvrage, promis au père Mersenne, et défendant le religieux français contre les accusations d’un cabaliste et astrologue anglais.
Il rentre à Paris en août 1629 (il a 37 ans) pour y apprendre les ravages de la peste qui a dépeuplé Digne. Inquiet pour ses amis, il multiplie les correspondances et se fait livrer d’Allemagne un élixir qu’il expédie à Digne. Ses efforts n’empêcheront pas les quatre-cinquièmes des dignois de succomber à l’épidémie. Gassendi restera à Paris trois ans , de 1629 à 1632 : il s’y affirme dans le domaine de l’astronomie (éclipses de soleil, observation de Mercure), de la physique (variations de déclinaison de l’aimant), écrit aux savants de l’Europe entière et s’en fait apprécier. Surtout, il réunit tous les documents d’une recherche sur la Grèce ancienne, Epicure, et prépare ses œuvres maîtresses en les maturant longuement.
Agé de 40 ans (octobre 1632), Gassendi revient en Provence et à Digne où il séjournera un an, ne retrouvant que le petit nombre d’amis qui ont survécu à la peste. Il y apprend avec tristesse et consternation, la condamnation de Galilée par l’Inquisition et l’obligation qui est faite au grand savant italien, de rétracter, comme « erreur et hérésie », sa démonstration selon laquelle « la terre tourne d’un mouvement journalier ». Bien que persuadé de la pertinence des démonstrations de Galilée, Gassendi adoptera une attitude prudente et n’écrira une lettre de consolation au condamné que six mois plus tard ; mais dans toutes ses publications ultérieures, il défendra la même théorie. C’est pendant ce séjour dignois qu’il commencera à établir la liste évêques, préparant ainsi la future « Notice sur l’Eglise de Digne ».
C’est aussi à cette époque que le chapitre de Digne décide d’éliminer le titulaire du siège de prévôt, outré par son attitude, et élit Gassendi pour le remplacer. Le prévôt en place essaie de faire casser la décision des chanoines par le Parlement, et Gassendi est envoyé à Aix pour défendre les droits du chapitre … et son élection. Le procès sera interminable, Gassendi retrouve ses amis aixois avec plaisir et, avec eux, s’adonne à l’astronomie, aux expériences de physique et à l’anatomie. Il est enfin confirmé comme Prévôt de la Cathédrale de Digne, le 19 décembre1634.
Pendant les six années qui vont suivre (de 1635 à 1641), Gassendi sera provençal : tantôt à Digne où il exerce sa charge de Prévôt, soigne ses maladies fréquentes, effectue des observations ou rédige l’essentiel de son œuvre ; tantôt dans le Var, à Marseille ou à Aix, pour effectuer des observations de tous ordres, pour fréquenter le nouveau Gouverneur de Provence avec lequel il échangera plus de 350 lettres, et surtout pour soigner et assister son meilleur ami Peyresc jusqu’à son décès. Gassendi se remettra difficilement de cette perte, sa douleur lui fera interrompre ses recherches pendant plusieurs mois.
Il repart à Paris en 1641. Devenu célèbre dans l’Europe entière, notamment pour ses découvertes astronomiques et pour les méthodes d’observation des astres qu’il a mises au point, Gassendi publiera notamment durant cette période une réfutation des « Méditations » de Descartes, à la demande du père Mersenne – une « Vie de Claude Nicolas Fabry de Peyresc » – des observations sur Jupiter et ses satellites, qu’il sera le premier à dénombrer. L’un de ses protecteurs, Aumonier de France, lui signe un brevet de « Professeur de Mathématiques au Collège de France », c’est à dire de titulaire de la chaire d’Astronomie, que Gassendi, réticent pour des problèmes de santé, finit par accepter avec un codicille « le dispensant de faire les leçons tant que sa santé ou ses affaires ne le lui permettraient pas ». Malgré ses ennuis de santé, il effectuera ses cours ponctuellement et en publiera le contenu, véritable somme sur les connaissances astronomiques de l’époque. Mais, terriblement affecté par la mort d’un ami, d’une santé chancelante, cet effort pédagogique l’épuisera et il tombera si gravement malade, à l’âge de 55 ans, qu’on le donnera déjà pour mort en France et en Europe.
C’est durant cette maladie que paraît son livre sur « La vie et les mœurs d’Epicure », et qu’il a la satisfaction de voir son cours au Collège de France « Les Institutions Astronomiques » recueillir un tel succès qu’il faut les rééditer quatre ou cinq fois.
Malgré ses souffrances, il se réconcilie avec Descartes et, sur les conseils de ses médecins, se décide à rentrer en Provence pour se soigner, il a 56 ans. Très malade, restant à l’écart des évènements provençaux et nationaux, Gassendi essaye de retrouver la santé dans les montagnes de Digne. Il partage son temps entre Digne, Aix, Toulon et les Iles d’Hyères, multipliera les observations astronomiques et leur publication, entretiendra sa volumineuse correspondance et publiera la suite de son œuvre sur Epicure. Il continue à réunir les éléments pour sa « Notice sur l’Eglise de Digne ».
Mai 1653 : Gassendi, âgé de 61 ans se croit guéri de la phtisie. Il repart sur Paris, y retrouve ses amis et poursuit son œuvre, publiant une « Vie de Tycho-Brahe », célèbre astronome mort cinquante ans plus tôt, ce qui lui sert de prétexte pour établir une sorte d’histoire de l’astronomie – il achève et édite sa « Notice sur l’Eglise de Digne », un traité sur la musique et met en ordre l’édition de ses œuvres complètes.
Mais sa santé rechute en février 1655. Il s’en remet aux soins de ses amis médecins, qui l’affaiblissent encore en le saignant beaucoup. Malgré son état, il jeûne et reçoit la communion. Puis il s’éteint en récitant des psaumes, le 25 octobre 1655, à 4 heures de l’après-midi. Il avait 63 ans et 9 mois.
Pierre GASSENDI, ressources de la Société Scientifique et Littéraire
La Société Scientifique et Littéraire et Alpes-de-Haute-Provence est très attachée à l’œuvre de Pierre Gassendi.
Elle est d’ailleurs propriétaire à Champtercier d’une parcelle de terrain de cent-vingt mètres carrés sur laquelle des stèles et des panneaux commémoratifs signalent l’emplacement de la maison natale du Grand Homme.
Créée en 1878 par l’Abbé Féraud, la Société Scientifique et Littéraire publie chaque année ses « Chroniques de Haute Provence ». De nombreuses d’entre elles ont été consacrées totalement ou en partie à l’œuvre de Pierre Gassendi :
- Tome I (1880-1883) : Lettres et requêtes autographes inédites de Gassendi – Oraison funèbre pour Messire Pierre Gassendi
- Tomme II (1884-1886) : Généalogie de Gassendi
- Tome IV (1889-1890) : Une lettre de Gassendi aux consuls de Digne
- Tome V ( 1891-1892) : Gassendi en Sorbonne
- Tome XIII (1907-1908) : Gassendi et la Charité de Digne, 1657
- Tome XVI (1913-1914) : Inauguration à Champtercier d’un monument à Pierre Gassendi
- Tome XX N°144 (1924) : L’œuvre astronomique de Gassendi
- Tome XXX N°183 (1943) : Gassendi et l’expérience du Puy de Dôme
- Tome XXXII N°195 (1952) : L’horoscope de Gassendi
- Tome XXXVII N°253 (1963) : Pierre Gassendi
- N°293 (1982) : Gassendi a-t-il construit un automate ?
- N°297 (1984) : Digne-les-Bains, les personnages, Pierre Gassendi
- N°321 et 322 (1992), 323-324 (1993), 334 (1997) : Actes du colloque international Pierre Gassendi de Digne-les-Bains du 18 au 21 mai 1992
- N°350 (2003) : Pierre Gassendi (1592-1655), l’homme en son temps
- N°384 (2020) : Observations astronomiques en Haute-Provence
Pierre Gassendi, ressources de la médiathèque de Digne-les-Bains
La médiathèque François Mitterrand Provence Alpes Agglomération conserve dans ses collections des ouvrages de Pierre Gassendi ainsi que des écrits consacrés à Pierre Gassendi ou à l’étude de ses œuvres.
Certains de ses ouvrages sont empruntables par les lecteurs de la Médiathèque, d’autres sont à consulter sur place.
Pour les ouvrages conservés dans le fonds patrimonial, ceux-ci sont accessibles sur demande motivée (chercheurs) et sur rendez-vous.
La médiathèque est aussi dépositaire des ouvrages qui devaient constituer le Centre Gassendi. Ils ne sont pas empruntables.
Des œuvres de Gassendi ont été numérisées et sont consultables via le site Gassendi.fr, bibliothèque virtuelle initiée par la Médiathèque de Digne et menée en collaboration avec le Musée Gassendi et les Archives Départementales des Alpes-de-Haute-Provence, et Sylvie Taussig, chercheuse au CNRS.