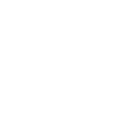Cette « Pépite de Chroniques » est extraite du numéro 3 des « Annales des Basses-Alpes » datant de 1887-1888, pages 107 à 112, texte intégral.
L’auteur nous livre un portrait charmant, poétique et plein de tendresse de l’orfèvre et bijoutier Antoine Colomb, né le 13 juin 1826 à Digne où il est mort le 7 juin 1906. Il fut l’inventeur des fameux bijoux de Digne, les « Etoiles de Saint-Vincent ». Il fut également, pendant une trentaine d’années, premier adjoint au maire de Digne.
Le père aux oiseaux
Nous avons, à Digne, un artiste de talent dont les doigts impitoyables mettent les métaux à la torture. L’or brillant, l’or mat, l’argent bruni, le nickel n’ont pas de secrets pour lui. La pierre de Saint-Vincent accepte avec docilité les chaines si élégantes que lui forge M. Colomb, le Benvenuto Cellini dignois.
M. Colomb est donc orfèvre et aurivelaire, c’est à dire batteur d’or. Il fait d’un lingot un voile, un tissu vaporeux, et, sous sa main, le cuivre prend la valeur de l’or.
M. Colomb est un homme fort occupé. Après avoir paré les jeunes filles de bijoux charmants, il les enrôle sous la bannière conjugale, en sa qualité d’adjoint ; il signe des passeports, mais non des permis de chasse, et vous saurez pourquoi ; il enregistre les naissances, embrasse les mariées et, chose moins poétique, il préside au besoin le conseil municipal.
M. Colomb est très estimé en ville. Sa générosité est proverbiale. Si on lui demande un bijou pour une bonne œuvre, il vous en donne trois. Saint Martin de la bijouterie, M. Colomb quitte au besoin son paletot, pour en couvrir les épaules d’un malheureux.
M. Colomb est donc parfait, me direz vous.
Hélas ! non. Chacun doit payer son tribut à la faiblesse humaine. Cet homme crée de charmants objets ; les comètes et les étoiles sortent parfaites de ses mains, mais on l’accuse d’être très lent dans son travail et, quand il a à réparer une tabatière, de la garder…..quatorze ans.
Quatorze ans, c’est beaucoup dire. Il faut toujours réduire de moitié les affirmations exagérées. Mettons sept ans et n’en parlons plus.
Cet homme a trop à faire, disent les gens pointus. On ne peut pas servir deux maitres à la fois. Pourquoi accepter les fonctions d’adjoint ? M. Colomb rend des services sans nul doute, mais, plus artiste qu’administrateur, il devrait, – une dernière fois ceint de son écharpe – , jurer une fidélité plus inviolable aux encrinites et aux tabatières.
A tous les reproches de négligence, Colomb oppose un front serein, et les excuses ne lui manquent pas. L’état civil a fonctionné plus que de coutume : naissances, mariages, décès, divorces, tout a donné. Il a présidé, le samedi, une distribution de prix et solennellement revêtu un nouveau garde champêtre du sabre et du baudrier. Le dimanche, il a fêté le jour du Seigneur. Ses ouvriers ont, à leur tour, fêté le jour du … lundi et même du mardi. Il est en mal d’un modèle nouveau dont l’éclosion est imminente, etc., etc.
La pratique s’en va mécontente et dans le dessein de…. retourner chez Colomb, qui, à la fin, calme le client, bien, très bien, quoique tardivement servi.
L’excuse vraie, Colomb ne la donne pas, et je vais vous la dire à l’oreille.
Voyez-vous cet ouvrier en blouse grise, à la casquette noire, aux longs cheveux bouclés, à la barbe poivre et sel, un panier sous le bras, se dirigeant deux fois par jour, le cigare aux lèvres, l’œil brillant, la figure contente, vers les jardins situés sous la préfecture ? C’est Colomb. Que va-t-il faire dans ce quartier, plein de neige et de glace en hiver, de boue au printemps, de poussière en été ? Suivons-le de loin, pour pénétrer le secret de ses allures mystérieuses.
Il faut le dire sans retard. Colomb est un homme grave. Soixante et un hivers ont blanchi ses casquettes noires. C’est donc un motif sérieux qui l’appelle dans ces parages écartés. Le mystère s’éclaircit bien vite. Des enfants suivent Colomb, en disant : « Vé, moussu Couloumb que vai fa teta ses passerouns « , et j’entends de petits cris venant de tous les points de l’horizon. Des oiseaux en troupes serrées se précipitent vers Colomb et tournent autour de lui comme pour le saluer. Dire que l’empressement des moineaux goulus est purement désintéressé, ce serait peut-être s’avancer beaucoup. Quoi qu’il en soit, Colomb se glisse doucement dans un petit jardin, et j’y entre sur ses talons.
Qui dit jardin devrait dire culture. Le jardin de Colomb n’est plus un jardin, c’est un forêt. Toutes les plantes de la création s’y coudoient dans une complète liberté. La vigne n’y a jamais subi l’insulte du sécateur, et le sorbier lui prête un fraternel appui. Le cerisier s’élève à côté d’eux et, comme le lierre, l’aubépine et le cormier, nourrit de ses fruits les oiseaux petits et grands. Le sapin, le thuya leur offrent un abri sérieux et respecté. L’herbe fine s’étend partout, et les ronces se marient aux lilas parfumés.
Dans un coin est une petite serre. J’y remarque des étagères vides, des bouts de cigares, quelques livres, deux chaises et une provision de noix.
Nous sommes envahis. Mille petits cris rappellent Colomb à ses devoirs de famille. Il jette sa pâture à la troupe affamée. La nourriture est variée selon les goûts de chacun: aux uns, les graines de diverses natures ; aux autres, les noix et le pain. L’un dévore tout sans prévoyance ; l’autre fait des provisions pour le lendemain.
Mais que signifient, au milieu du jardin, à la place d’un prétendu rond-point, ces bâtons plantés en terre, se croisant avec d’autres, et ces ficelles que la brise balance. Seraient-ce des filets ? Oh mon Dieu, non !
L’explication se présente d’elle-même. Colomb va vers le rond-point. Au bout des ficelles, sont fixées des coquilles de noix qu’il remplit tous les jours, et vous voyez à l’instant la mésange, le pinson, la fauvette, le bouvreuil, le chardonneret, le rouge-gorge, le bruant se pendre aux coquilles et en dévorer le contenu. Rien n’est plus grâcieux que ces frémissements d’ailes, ces balancements, ces virevoltes, ces coups de bec répétés et ces chants joyeux.
Je reviens à la serre. Ce panier et son contenu m’intriguent. Soulevons le couvercle, pendant que Colomb a le dos tourné. J’y découvre du blé, des tranches de pain, des amandes, des pommes (c’est le dessert) et, détail prosaïque, dans un petit pot, un restant de soupe de vermicelle. Il parait qu’un magnifique merle siffleur, en habit noir, en bottes jaunes, est un des assidus du jardin et a un faible pour le vermicelle. Permettez-moi de vous le dire, beau merle. Votre tenue est des plus correctes, mais vos goûts sont bien dépravés !
Le couvert mis, Colomb revient dans la serre, fume son cigare, casse des noix et appelle les petites mésanges, qui viennent en cueillir des morceaux à ses pieds. Et Colomb me dépeint les habitudes, les goûts, les passions de ces petits êtres qu’il aime tant. Il s’indigne à la pensée que le fusil et le filet détruisent en grande partie ces pauvres bêtes, qui font le charme de la campagne et rendent tant de services à l’agriculture. On sent, sous cette blouse d’ouvrier, une âme tendre et douce, un cœur compatissant et chaud.
Dans le cours de notre causerie, je demande s’il n’y a pas dans le voisinage une source qui puisse fournir le bain et le boire, avant et après les repas, et j’apprends avec plaisir, mais sans surprise, que, par une délicatesse de plus, Colomb a pensé à la boisson comme à la nourriture. Un baquet ad hoc est rempli d’eau fraiche et, quand le froid l’a changée en pierre, la glace est brisée le lendemain à coups de marteau.
La bonté de Colomb exerce son empire même sur les natures grossières. Les pierrots gourmands et effrontés sont pleins de reconnaissance pour lui et viennent, tous les ans, présenter leur jeune couvée à l’amphytrion attendri, qui, pendant tout le repas, appelle ses invités par de petits cris d’amitié : petit, petit, petit ! et chaque invité lui répond par un gazouillis délicieux.
Au grand désespoir de Colomb, il manque, hélas ! plus d’une fois à l’appel, un doux pensionnaire bien connu et qui est tombé dans les griffes d’un gros matou du voisinage ou du terrible épervier que les cris d’alarme de la mésange et du pinson n’ont pu éloigner.
Et voilà pourquoi le temps fait défaut à Colomb. Voilà pourquoi il met quatorze ans à réparer une tabatière. N’accusez ni l’administration, ni l’état civil. Prenez-vous en à la nature, aux fleurs, aux oiseaux ; mais vous n’aurez pas le cœur de leur en vouloir. Ils rendent encore meilleur un homme excellent, et ce contact inspire l’artiste délicat, le délasse de ses travaux et lui donne des forces pour le lendemain.
Vous avez quelque chose à faire encore, mon brave Colomb. Au premier souffle du printemps et du renouveau, vous aurez un panier à chaque bras ; dans l’un, la nourriture, aussi abondante que variée ; dans l’autre, le duvet, la laine et la mousse, doux et chauds éléments du nid, cet abri mystérieux des amours. Vous serez bien alors le père aux oiseaux. Grâce à vous, la mère, couchée sur ses petits, aura un sommeil tranquille, un réveil exempt d’alarmes. La paix, le gîte, le vivre, l’eau, le nid, l’affection, vous aurez tout donné aux oiseaux du bon Dieu, et, comme dit la vieille chanson, le bon Dieu vous le rendra.
C. GORDE de la Société Scientifique et littéraire des Basses-Alpes